|
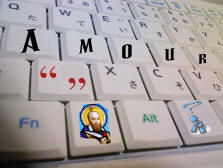
Edito n°- 30
L'édito 29 date du
dimanche 28 janvier 2017
Le site
mérite bien
un nouvel Edito
en sortie d'été !
|
 |
Les jeunes croient
plus en Dieu que leurs parents ...
|
 |
dimanche
3 septembre 2017
|
Engagez-vous ! Qui disaient !
Aujourd’hui, à 18-24 ans, on croit plus en Dieu qu’hier !
Une étude sur les jeunes
et la vie consacrée (Opinion Way - février 2016) parlait des 18-24 ans comme
une génération qui, loin de rejeter la religion catholique, vit de nouvelles
formes de rapport à Dieu.
Les jeunes croient plus
en Dieu que leurs parents :c'est le premier enseignement fort de cette étude
: l'existence de Dieu est probable pour 51% des 18-24 ans, contre 38% de
l'ensemble des français. La pratique régulière est également plus forte chez
les jeunes : 11% d'entre eux déclarent pratiquer au moins une fois par mois,
contre 8% pour l'ensemble des français. En mars 2013, une note d'analyse du
CSA de mars 2013 sur le catholicisme en France évoquait déjà un regain
religieux chez les jeunes. Seuls 31% des 18-24 ans se présentaient comme
incroyants, contre 78% des plus de 65 ans.
Malgré cela en France,
le nombre des vocations consacrées (religieuses apostoliques, religieux,
moniales) étaient 66 462 en 2000 et n'étaient plus que 32 399 en 2014.
Pourtant 15% des 18-24 ans, affirment avoir déjà pensé à la vie religieuse.
La réticence à faire le choix de la vie religieuse !
Les causes sont multiples :
- Les instituts semblent habités que par des anciens. Les communautés
n’apparaissent pas intergénérationnelles.
- Aujourd’hui nous arrivons à la vie religieuse avec plus d’années riches
d’expériences de vie et de formations : comment s’épanouir dans un
engagement religieux autre que classique (classes comme enseignant, vie
paroissiale...) en valorisant ses choix de formation antérieure ?!
- La mondialisation et la technologie dirigent maintenant les aventures de
la planète. Une peur s’installe de devoir renoncer aux médias et réseaux
sociaux.
- Difficulté à franchir le pas d’un engagement dans un monde qui craint la
promesse et ce qui dure. Et un mode qui appréhende également la réaction de
l’entourage, famille et amis.
L’ambivalence d’un discours sur la vocation !
Parler vocation serait-il envisager un discours trop
magique ? Trop désincarné !
Car le réflexe est de placer la vocation (vocare)
du côté de l’appel. Sous entendu de l’appel personnel de Dieu !
Mais l’appel, même divin, est médiatisé par
l’humain, une expérience de vie, un temps fort, une rencontre avec une
personne qui est liée à l’appel...
Et puis un appel pour quoi ?
Pour suivre le chemin du Christ, mon chemin ou un chemin tout tracé ?
Le sens de la vocation se découvre tout à la fois en nous même, en ce que
nous pouvons espérer et vivre, en l’appel christique, et en même temps en
l’appel que l'on reçoit d'un autre, de l'Église.
Et puis la vocation ne suffit pas !
Il s’agit de franchir des pas, de la vocation à
l’engagement, de l’appel à la réponse. Il s’agit de dépasser le stade de
l’engagement pour « s’investir ». L’investissement du religieux par sa
profession se mesure à son degré d’implication personnelle, de créativité,
dans la communauté immédiate, où des frères sont amenés à cohabités, à
correspondre, à s’entre-supporter comme aime à le dire F de Sales, dans la
spiritualité et le monde pluriel qu’il nous faut sans cesse apprendre à
aimer !
Le ritualisme, la reproduction de schémas religieux, la copie conforme, à un
modèle de formation inculqué, porté parfois par un jeu étriqué, falsifié, de
l’obéissance, ... tout cela appauvrit le champ de la vie religieuse, empêche
toute créativité, et enferme dans un modèle de reproduction à l’identique,
sous entendu à l’authentique !
Si le baptême nous fait
participer à la dignité de Christ, ...
...comme prêtre, prophète et roi, la vie religieuse
nous appelle à vivre la radicalité du prophétisme : prophètes dans notre
manière de vivre, prophètes qui oblige d’aller aux périphéries et prophète
dans la joie ! Notre monde a un impérieux besoin du témoignage prophétique
que donne la vie religieuse, pour favoriser une culture de vie face à
l’individualisme régnant et face aux cultures de mort. La vie religieuse,
aujourd’hui, appelle à se libérer du poids des institutions et à devenir des
frères prompts à envisager les besoins actuels et à
y répondre en se donnant des nouvelles possibilités de développement.
« Les
religieux, après s’être concentrés sur le moi et l’ascèse et après s’être
tournés vers les autres en les aidant à se relever des effets de la
déshumanisation des derniers siècles, doivent maintenant travailler
davantage sur les causes systémiques de cette déshumanisation... Leur but
sera de promouvoir une solidarité mondiale dans un monde interconnecté non
violent. Comme le dit le Pape Jean-Paul II : à la mondialisation de mort,
nous devons opposer ou, mieux encore, proposer la mondialisation de la
solidarité. » Michel Côté, o.p., "Que sera la vie religieuse demain ?" |